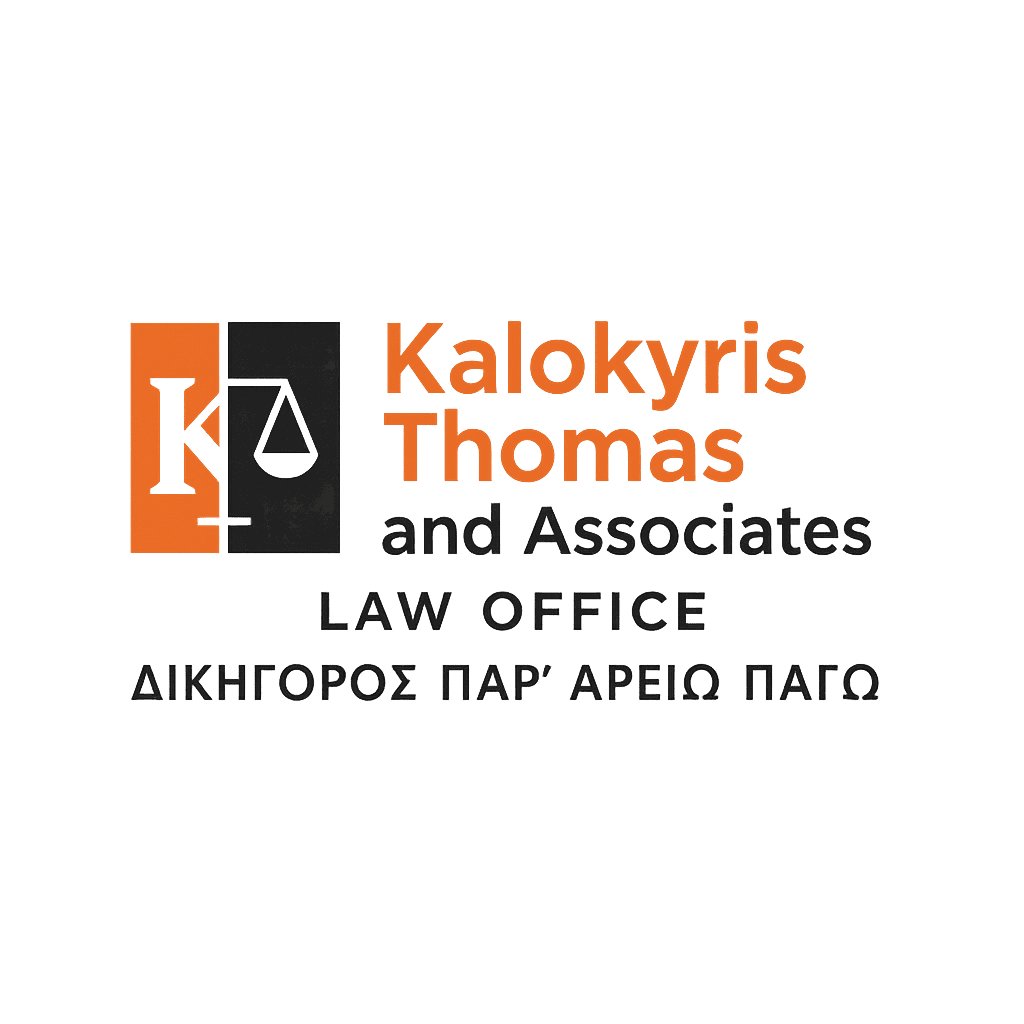Un contrat de distribution commerciale est un contrat par lequel un commerçant indépendant s'engage à vendre les produits du fournisseur de manière continue et stable à ce dernier.[1]. La différence essentielle entre un contrat de distribution et un contrat d'agence commerciale est que le distributeur agit en son nom et pour son propre compte et supporte donc lui-même le risque commercial, contrairement à l'agent commercial qui agit au nom et pour le compte du mandant et qui supporte donc le risque d'écoulement des produits.
Une conséquence du principe de l'autonomie de la volonté privée est le principe de la liberté contractuelle, qui est indirectement établi par l'article 361 CC en tant qu'expression de la liberté économique, qui est également un droit individuel garanti par l'article 5§1 de la Constitution.[2]. Le contrat de distribution exclusive est une manifestation du principe de la liberté contractuelle. Ce contrat est un type particulier de contrat continu de coopération commerciale en vertu duquel une partie, le producteur ou le grossiste, est tenue de vendre exclusivement à l'autre partie, le distributeur, les marchandises convenues en rapport avec une certaine zone géographique et que le distributeur revend ensuite à des tiers en son propre nom, pour son propre compte et à ses propres risques, c'est-à-dire qu'il agit en tant qu'intermédiaire professionnel indépendant dans les transactions commerciales.
En outre, dans le cadre du contrat de distribution exclusive, le distributeur s'engage généralement à suivre les instructions du producteur en ce qui concerne l'apparence et la qualité des produits, à promouvoir les ventes, à protéger les intérêts et la réputation du producteur, à détenir les stocks nécessaires pour éviter les pénuries sur le marché, à maintenir à ses frais une organisation et une infrastructure appropriées, et même s'il a le droit de déterminer les prix de revente des produits à des tiers, il est possible qu'ils soient fixés contractuellement.
L'exclusivité dans la distribution de certains produits signifie notamment que le producteur s'engage par contrat à ne pas livrer de marchandises à des tiers concurrents du distributeur exclusif dans la zone de distribution et, inversement, que le distributeur exclusif est, en règle générale, tenu de ne pas distribuer de produits directement concurrents dans la même zone.[3].
La relation du distributeur non seulement avec son homologue, mais aussi avec d'autres distributeurs exclusifs du même producteur ou grossiste opérant dans une zone de distribution exclusive différente, présente un intérêt particulier au regard du droit de la concurrence. Une question se pose dans ce cas lorsque l'activité du distributeur exclusif s'étend au-delà de son propre territoire dans la zone d'un autre distributeur. L'admissibilité des ventes dépend alors de leur caractère actif ou passif. En particulier, selon l'article 2 du décret 69/2005, le terme "ventes actives" se réfère à :
- approcher de manière proactive des clients individuels dans le territoire exclusif ou dans le groupe de clients exclusifs d'un autre distributeur
- approcher activement un groupe spécifique de clients ou les clients d'un territoire spécifique exclusivement attribué à un autre distributeur, par le biais d'une publicité dans les médias ou d'autres activités promotionnelles visant spécifiquement ce groupe de clients ou les clients situés sur ce territoire ; ou
- l'établissement d'un entrepôt ou d'un centre de distribution sur le territoire exclusif d'un autre distributeur.
En revanche, la vente passive est définie comme la réponse à la demande exprimée spontanément par des clients individuels, y compris la distribution de biens ou de services à ces derniers et la publicité générale ou la promotion par le biais des médias ou d'Internet, qui atteint des clients situés dans des territoires exclusifs ou appartenant aux groupes de clients d'autres distributeurs, mais qui nécessite un moyen raisonnable d'atteindre des clients en dehors de ces territoires ou groupes de clients.
Comme il ressort clairement de ce qui précède, les ventes actives par un distributeur dans la zone de distribution exclusive d'un autre distributeur sont des ventes interdites, tandis que les ventes passives sont en principe autorisées, à condition que l'approche des clients appartenant à l'autre zone se fasse de manière raisonnable. Une manière raisonnable consiste, par exemple, à répondre à la demande d'un client qui s'adresse lui-même au distributeur sur son territoire exclusif. L'existence d'un site web est considérée comme une forme de vente passive, qui est toujours autorisée, car il s'agit d'un moyen raisonnable pour les clients d'approcher le distributeur exclusif. En d'autres termes, une fois que le client visite le site web du distributeur, contacte le distributeur et conclut un contrat de vente avec lui, cette vente est passive et est toujours autorisée.
Restrictions sur les accords verticaux[4] découlent directement du droit communautaire de la concurrence. Les accords verticaux sont définis comme des accords entre entreprises opérant à différents niveaux (par exemple, l'accord entre un producteur, un grossiste et un distributeur), tandis que leurs restrictions concernent les conditions dans lesquelles les parties peuvent acheter, vendre ou revendre certains biens ou services (par exemple, l'accord entre un producteur, un grossiste et un distributeur).Le cadre juridique comprend à la fois la clause d'interdiction générale (article 81 du traité CE) et le règlement 330/2010 sur l'exemption par catégorie pour les accords verticaux, qui a remplacé le précédent règlement 2790/1999.[5].
Ces caractéristiques distinguent donc le contrat de distribution exclusive de celui de l'agent commercial. En effet, l'agent commercial est défini comme un intermédiaire indépendant chargé de façon permanente, moyennant des honoraires (commission) et généralement pour un territoire déterminé, soit de négocier la vente ou l'achat de marchandises pour le compte d'une autre personne, c'est-à-dire le mandant, soit de négocier et de conclure ces contrats pour le compte et au nom du mandant, c'est-à-dire à la différence de l'agent commercial, de négocier et de conclure des contrats de vente ou d'achat de marchandises pour le compte d'une autre personne, c'est-à-dire pour le compte et au nom du mandant.[6]. Un type de personne intermédiaire, qui agit également en tant qu'intermédiaire dans le fonctionnement du commerce, est l'agent donneur d'ordre, c'est-à-dire la personne qui effectue les opérations susmentionnées en son nom propre, comme le distributeur exclusif, mais pour le compte du donneur d'ordre.
La distribution sélective concerne généralement les produits de luxe ou de haute technologie, pour lesquels un réseau est nécessaire afin de garantir l'authenticité, la disponibilité de gammes complètes de produits, le service, la garantie, l'entretien, une publicité et une présentation adéquates, l'expérience des vendeurs, etc. Bien qu'il n'y ait pas d'exclusivité territoriale, les distributeurs ont l'obligation de ne pas vendre les produits en question à des revendeurs non agréés. Un tel réseau est considéré comme "fermé" dans la mesure où l'on veille à ce que les biens ne tombent pas entre les mains de commerçants tiers et où le producteur doit prendre des mesures pour assurer l'étanchéité du réseau et éviter qu'il ne se désagrège.[7].
Grâce à la distribution sélective des fuites qui le caractérise, le service au consommateur est favorisé, tandis que le renforcement et la protection des réseaux protègent la réputation du produit et renforcent la concurrence entre produits similaires. La sélection des distributeurs et l'entrée dans le réseau doivent se fonder sur des critères uniformes et objectifs relatifs à la spécialisation professionnelle des distributeurs, à leur expérience, à leur personnel et à leurs installations.
Dans la décision Métro/Cartier (C-376/92), la CJCE a considéré comme légale l'étanchéité, en ce qui concerne le réseau de distribution sélective, soit par des interdictions de revente, soit par des clauses similaires, telles que l'exclusion de la garantie du producteur des produits vendus par des vendeurs extérieurs au réseau, a-t-il expliqué, que l'inverse n'est cependant pas vrai, c'est-à-dire que l'étanchéité est un atout du réseau nécessaire à sa compatibilité avec l'article 85 (aujourd'hui 81 TCE), soulignant qu'il serait paradoxal de traiter plus favorablement des systèmes plus fermés que des systèmes plus ouverts[8].
Dans la décision Pierre Fabre Dermo–Cosmosétique SAS/Président fr l'Auteuré fr la accord et Ministre fr l'Économie, fr l'L'industrie et fr l'Emploi (C-439/09), la CJCE a jugé que l'organisation d'un tel réseau de distribution sélective ne tombe pas sous le coup de l'interdiction de l'article 101, paragraphe 1, du TFUE relatif à la protection de la concurrence si le choix des revendeurs se fait sur la base de critères objectifs de nature qualitative appliqués uniformément à tous les revendeurs potentiels et sans discrimination, que les propriétés du produit en cause rendent un tel réseau de distribution nécessaire pour maintenir la qualité et assurer le bon usage des produits en cause, et que le choix des revendeurs se fait sur la base de critères objectifs de nature qualitative appliqués uniformément à tous les revendeurs potentiels et sans discrimination, que les propriétés du produit en cause rendent un tel réseau de distribution nécessaire pour maintenir la qualité et assurer le bon usage des produits en cause, et[9].
[1] George D. Triantafyllakis, Recommandations en matière de droit commercial, pp. 80.
[2] Voir. AP 455/2014, Loi sur les banques d'informations juridiques (intrasoft international) : "...la liberté contractuelle signifie (a) la liberté de l'individu de conclure ou de ne pas conclure un contrat à la fois de manière générale et avec une personne déterminée en tant que partie contractante (liberté de choisir la partie contractante) et (b) la liberté de déterminer le contenu du contrat.».
[3] M. Varela/C. Triantafyllakis, Applications du droit commercialVolume A, sous la direction de C. Triandafyllakis, Nomiki Bibliothiki SA, 2007, p. 188.
[4] Voir. 9656/2013 BR THESS, Information juridique Loi sur les banques : "Ces accords verticaux autorisés sont ceux qui sont de minimis parce qu'ils sont conclus entre des entreprises dont la part de marché sur le marché en cause ne dépasse pas 10%. Toutefois, s'ils comprennent des restrictions verticales strictement concurrentielles figurant sur la "liste noire" de l'article 4 du règlement, l'article 81, paragraphe 1, du TFUE leur est également applicable (voir à ce sujet le contexte de l'article 4, paragraphe 1, du règlement). 1 du TFUE leur est également applicable (voir, dans ce contexte, l'article 1, paragraphe 1, point c), du TFUE). Article 1, paragraphe 1, point c), du traité CE. En d'autres termes, ces accords verticaux sont automatiquement invalides, conformément au deuxième paragraphe, à condition toutefois que leur mise en œuvre ait des effets sensibles sur le commerce entre États membres, ainsi que sur la concurrence. Enfin, en ce qui concerne les accords de franchise en particulier, les obligations des parties contenues dans ces accords peuvent être considérées comme nécessaires au maintien de l'identité commune et de la réputation du réseau de franchise et ne relèvent donc pas du champ d'application de l'article 81, paragraphe 1, point b). 1 du TFUE ou, même si c'est le cas, remplissent les conditions d'exemption prévues au paragraphe 3. En outre, les accords verticaux contenus dans les accords de franchise peuvent légalement, conformément à l'article 5 du règlement (CE) n° 2790/1999, inclure une obligation de non-concurrence post-contractuelle, c'est-à-dire toute obligation directe ou indirecte du franchisé de ne pas acheter, vendre ou revendre les biens ou services visés dans l'accord après la résiliation de ce dernier. Selon les dispositions ci-dessus, l'obligation de non-concurrence post-contractuelle doit être limitée aux locaux où le franchisé a exercé son activité commerciale pendant la durée du contrat, doit être nécessaire pour protéger le savoir-faire transféré du franchiseur au franchisé et doit être limitée dans le temps à un an après la résiliation du contrat (cf. D. Kostakis, Franchising and the new Commission Regulation (EC) 2790/1999 on the application of Article 81(1)(b) of the EC Treaty. 3 du Traité à certaines catégories d'accords verticaux et de pratiques concertées, CJUE 2000, 712, Cf. Voir. et AP 1063/2011, Loi sur la banque d'informations juridiques
[5] Dimitris Stef. Kostakis, Le nouveau règlement 330/2010 de la Commission sur l'application de l'article 101, paragraphe 1, point a), du traité à la mise en œuvre de l'article 101, paragraphe 1, point a), du traité. 3, www.franchiseportal.gr
[6] Voir. Eph. Athènes 5826/2010, Revue de droit commercial, Volume XB, 2011, numéro 1Le.
[7] Lambros Kochiris - Système de distribution sélective et importations parallèles en vertu du droit communautaireOpinion, Commercial Law Review, Volume XB, Issue 4Le, pp. 977 et suivants.
[8] Christopher Stothers - Parallèle Commerce en L'Europe : Intellectuelle Propriété, Compétition et Réglementation DroitHart Publishing, 2007 USA, p. 409 - En l'espèce, Cartier a refusé de fournir une garantie pour les montres vendues par la chaîne Metro cash and carry, qui n'était pas un distributeur agréé. La Cour de justice de l'Union européenne (anciennement Cour de justice des Communautés européennes) a été saisie et a jugé que, dès lors que Cartier maintenait un réseau de distribution sélective au sens de l'article 81 du traité CE, elle était en droit de n'accorder une garantie que pour les ventes effectuées par les distributeurs sélectionnés qu'elle avait inclus dans le système.
[9] www.curia.europa.eu - Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 13 octobre 2011 - Pierre Fabre Dermo-Cosmétique SAS/Président de l'Autorité de la concurrence et Ministre de l'Économie, de l'Industrie et de l'Emploi - Pierre Fabre a interdit aux revendeurs de son réseau de distribution sélective de vendre des produits sur Internet. La CJUE a jugé qu'il appartient à la juridiction de renvoi d'examiner si la clause contractuelle en cause, qui interdit de facto toute forme de vente par Internet, peut être objectivement justifiée et que la Cour de justice doit lui fournir les éléments d'interprétation pertinents du droit de l'Union européenne qui lui permettront de rendre sa décision. La Cour n'a pas retenu, en ce qui concerne les libertés de circulation, pour justifier l'interdiction de la vente par Internet, les arguments fondés sur la nécessité de fournir un conseil personnalisé au client et d'assurer la protection contre le mauvais usage des produits dans le cas de la vente de lentilles de contact et de médicaments pour lesquels une ordonnance n'est pas nécessaire. Pierre Fabre Dermo-Cosmétique invoque également la nécessité de préserver l'image de prestige des produits en cause. L'objectif de préservation de l'image d'un produit ne saurait constituer un motif légitime de restriction de la concurrence et ne saurait donc justifier la constatation qu'une clause contractuelle poursuivant cet objectif ne relève pas du champ d'application de l'article 101, paragraphe 1, TFUE. Eu égard aux considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre à la première partie de la question posée que l'article 101, paragraphe 1, TFUE doit être interprété en ce sens qu'une clause contractuelle, dans le cadre d'un système de distribution sélective, qui exige que les ventes de produits cosmétiques et de soins personnels aient lieu dans un lieu physiquement présent en présence obligatoire d'un pharmacien diplômé, ce qui a pour conséquence d'interdire l'utilisation d'Internet pour ces ventes, constitue une restriction per se au sens de cette disposition si, à la suite d'une enquête menée par la société Pierre Fabre Dermo-Cosmétique est une société appartenant au groupe Pierre Fabre qui a pour activité principale la fabrication et la commercialisation de produits cosmétiques et d'hygiène corporelle et qui dispose de différentes filiales, dont les laboratoires cosmétiques Klorane, Ducray, Galénic et Avène, dont les produits cosmétiques et d'hygiène corporelle sont commercialisés sur le marché français et européen sous ces marques, notamment en pharmacie. Les produits en cause sont des produits cosmétiques et d'hygiène corporelle qui n'entrent pas dans la catégorie des médicaments et ne sont donc pas soumis au monopole des pharmaciens prévu par le code de la santé publique. En 2007, le groupe Pierre Fabre détenait une part de 20 % sur le marché français de ces produits. Les contrats de distribution de ces produits, qui portent les marques Klorane, Ducray, Galénic et Avène, prévoient que la vente doit être effectuée exclusivement dans un lieu physique et en présence d'un pharmacien diplômé.
THOMAS STEF. HEUREUX
AVOCAT